Actu politico-politique
Modérateur: Modérateurs
Re: Actu politico-politique
iamaseb la faute vient de qui concernant :
- fraudes fiscales (du Grec le plus important à celui "labmda), abus de tva, taxe foncière, abus de prestations (ex : aveugles)
- fraudes sur les comptes du pays
J'ai d'autres exemples si tu le souhaites..
C'est aussi l'Europe?
- fraudes fiscales (du Grec le plus important à celui "labmda), abus de tva, taxe foncière, abus de prestations (ex : aveugles)
- fraudes sur les comptes du pays
J'ai d'autres exemples si tu le souhaites..
C'est aussi l'Europe?
-

Thor - Assidu

- Messages: 3515
- Enregistré le: 22 Nov 2005, 16:51
- Localisation: Qu'est-ce que ça peut te foutre?
Re: Actu politico-politique
Et ça repart comme en quarante !
- Marché Baila
- Banni

- Messages: 984
- Enregistré le: 13 Jan 2012, 16:51
Re: Actu politico-politique
Thør a écrit:iamaseb la faute vient de qui concernant :
- fraudes fiscales (du Grec le plus important à celui "labmda), abus de tva, taxe foncière, abus de prestations (ex : aveugles)
- fraudes sur les comptes du pays
J'ai d'autres exemples si tu le souhaites..
C'est aussi l'Europe?
Comment ça ? Une société perverti par l'égoïsme ne fonctionne pas ? La recherche de l'intérêt particulier à l'échelle de l’individu ne produit pas un bien fait pour la collectivité ?
Ça fait des années que j'ai conscience de ça, je ne suis pas libéral.
Mais on parlait ici de "l'aide". Cette "aide" faite par des gens qui justement n'hésitent pas à frauder, à commencer par le président de la Commission Européenne...
L'arbre est mort, impuissant mais lucides, nous regardons les feuilles tomber, les unes après les autres.
- iamaseb
- Habituel

- Messages: 8938
- Enregistré le: 14 Fév 2003, 22:05
Re: Actu politico-politique
Information
Goldman Sachs avait échangé de la dette grecque à un taux fictif en 2001, permettant à Athènes de maquiller ses comptes publics. Aujourd'hui le pays fortement endetté doit 600 millions d'euros à la banque américaine.
Le coup de main de Goldman Sachs à la Grèce pour maquiller ses comptes lui aura rapporté quelque 600 millions d'euros, révèlent Nick Dunbar et Elisa Martinuzzi, dans un article de l'agence Bloomberg. Les deux journalistes ont recueilli les confessions de Christoforos Sardelis, chef du bureau de gestion de la dette à Athènes entre 1999 et 2004, et de son successeur Spyros Papanicolaou. Pour la première fois, l'accord qui a lié la banque d'investissement à l'Etat grec dès 2001 est évoqué publiquement par des personnes directement impliquées dans le dossier.
En 2001, la Grèce et "la firme" se sont entendus pour échanger de la dette grecque à un taux de change fictif afin de réduire de 2% l'endettement hellène. Le gouvernement grec doit alors 600 millions d'euros à Goldman Sachs, en plus des 2,8 milliards empruntés. Ces 600 millions d'euros ont représenté 12% des 6,35 milliards de dollars gagnés par Goldman Sachs au titre de ses principaux investissements en 2001.
"Une histoire sulfureuse"
Mais le produit dérivé utilisé pour dissimuler l'opération et vendu par la banque américaine a fait bondir la dette du pays européen envers la banque d'investissement. De quelque 2,8 milliards d'euros en 2001, elle a presque doublé à 5,1 milliards d'euros en 2005.
"L'accord Goldman Sachs est une histoire sulfureuse entre deux pécheurs", a commenté Christoforos Sardelis, en place en 2001 lorsque la prestation a été vendue. L'accord lui paraissait alors correct pour son pays. "Mais après le 11-septembre 2001, nous avons réalisé que la formule n'était pas la bonne", a-t-il expliqué. La chute du marché obligataire suite aux attentats a fortement pesé sur les remboursements. Et la révision de l'accord en 2002 qui basait désormais les remboursements sur un indice relié à l'inflation dans la zone euro a fait exploser la dette.
Le coup de main de Goldman Sachs à la Grèce pour maquiller ses comptes lui aura rapporté quelque 600 millions d'euros, révèlent Nick Dunbar et Elisa Martinuzzi, dans un article de l'agence Bloomberg. Les deux journalistes ont recueilli les confessions de Christoforos Sardelis, chef du bureau de gestion de la dette à Athènes entre 1999 et 2004, et de son successeur Spyros Papanicolaou. Pour la première fois, l'accord qui a lié la banque d'investissement à l'Etat grec dès 2001 est évoqué publiquement par des personnes directement impliquées dans le dossier.
En 2001, la Grèce et "la firme" se sont entendus pour échanger de la dette grecque à un taux de change fictif afin de réduire de 2% l'endettement hellène. Le gouvernement grec doit alors 600 millions d'euros à Goldman Sachs, en plus des 2,8 milliards empruntés. Ces 600 millions d'euros ont représenté 12% des 6,35 milliards de dollars gagnés par Goldman Sachs au titre de ses principaux investissements en 2001.
"Une histoire sulfureuse"
Mais le produit dérivé utilisé pour dissimuler l'opération et vendu par la banque américaine a fait bondir la dette du pays européen envers la banque d'investissement. De quelque 2,8 milliards d'euros en 2001, elle a presque doublé à 5,1 milliards d'euros en 2005.
"L'accord Goldman Sachs est une histoire sulfureuse entre deux pécheurs", a commenté Christoforos Sardelis, en place en 2001 lorsque la prestation a été vendue. L'accord lui paraissait alors correct pour son pays. "Mais après le 11-septembre 2001, nous avons réalisé que la formule n'était pas la bonne", a-t-il expliqué. La chute du marché obligataire suite aux attentats a fortement pesé sur les remboursements. Et la révision de l'accord en 2002 qui basait désormais les remboursements sur un indice relié à l'inflation dans la zone euro a fait exploser la dette.
C'est bizarre on retrouve comme pour les Subprimes Goldman and sachs mais c'est juste une coïncidence....
Information
La banque est accusée d’avoir spéculé sur la faillite de la Grèce tout en conseillant Athènes depuis des années.
Et si Michael Moore, et son film Capitalism : a Love Story, était bien en deçà de la réalité ? Et si le fleuron des «banksters», le surnom que Main street, l’homme de la rue, donne depuis la crise aux banquiers de Wall Street, était au cœur d’une affaire de subprimes étatique en Europe ? Goldman Sachs, la banque la plus puissante du monde, a spéculé sur le dos de la Grèce tout en se faisant rémunérer par Athènes pour l’aider à gérer sa dette. Voilà l’accusation qui trotte dans la tête de tous les banquiers européens. Et même au-delà. Fait rarissime, les politiques sont montés au créneau pour mettre en doute l’intégrité de la pieuvre Goldman Sachs. Sans jamais la nommer, la chancelière allemande Angela Merkel a dégainé la première mercredi. Elle juge «scandaleux» que certaines banques aient pu aider à maquiller le déficit budgétaire de la Grèce et provoquer ainsi une crise de toute la zone euro. Le lendemain, c’est au tour de la ministre de l’Economie, Christine Lagarde de se demander si «The Firm», comme on la surnomme, avait aidé la Grèce à maquiller la réalité de sa dette. «C’est une question à laquelle on doit avoir la réponse», a-t-elle dit sur France Inter. Ce n’est pas la seule. La banque américaine aux 13,3 milliards de dollars de bénéfice en 2009 est de tous les conflits d’intérêts potentiels dans cette crise grecque. A la fois conseiller et spéculateur. Bref le pire visage de la finance mondialisée…
Destination Athènes
Nous sommes début novembre 2009. Le nouveau gouvernement socialiste de George Papandreou s’arrache les cheveux. Comment convaincre les marchés et Bruxelles qu’il pourra bien tenir son programme d’austérité pour réduire une dette abyssale (112 %du PIB) ? La situation semble intenable. C’est à cette date, raconte le New York Times, qu’une délégation de banquiers de Goldman Sachs emmenée par leur numéro 2, Gary Cohn, débarque à Athènes. Nos chers banquiers ont pris rendez-vous pour présenter leur dernière petite merveille : «Un instrument financier permettant de remettre à un avenir très lointain le coût de système de santé du pays.» Et donc permettre à Athènes de se redonner un peu d’air. Goldman Sachs se sent ici un peu chez elle. Gary Cohn aurait rencontré au moins à deux reprises le Premier ministre grec. Cette proximité n’étonne personne. «Cela fait partie de la culture de la finance américaine et particulièrement de Goldman Sachs d’entretenir un contact direct avec les chefs d’Etat ou leur ministre des finances», raconte un banquier européen. L’ex-institution d’Henry Paulson, le secrétaire d’Etat au Trésor de George Bush, connaît très bien toutes les subtilités de la dette grecque. Il en fait une spécialité. «Goldman ne s’intéresse pas au marché de la dette des grands pays comme la France ou l’Allemagne, il préfère celle des petits, comme la Grèce ou le Portugal, car elle est plus volatile et donc plus spéculative, assure un responsable de la dette d’un pays européen. C’est beaucoup plus facile de se faire de l’argent vite». Et plus discrètement.
Déjà, entre 2001 et 2004, Goldman Sachs se retrouve à la manœuvre pour aider les Grecs à camoufler leur dette. Comment ? De deux façons distinctes. D’abord, grâce à des swaps de change. Des swaps, késako ? Quand un pays vend sa dette au marché, il a la possibilité d’émettre des obligations en euros ou libellées dans une autre monnaie. Pour se couvrir contre le risque de change, le gouvernement en question a recours à des instruments financiers (les fameux swaps). Jusque-là, rien que de très normal. Plusieurs pays ont utilisé ce type de technique, assez basique. Là où l’affaire se complique, et peut se révéler, pour le coup, illégale aux yeux de la Commission européenne, c’est que le gouvernement et sa banque conseil peuvent décider de changer en cours de route la parité du taux de change de leur couverture. Sans en avertir personne. Et donc d’améliorer - artificiellement - la valeur de leur dette. L’autre astuce, c’est d’anticiper des recettes futures. C’est ce qu’aurait recommandé Goldman Sachs au gouvernement conservateur de l’époque en «anticipant notamment le versement des redevances d’aéroport, pour lui permettre de faire baisser sa dette d’un montant de 0,5 % point de PIB», selon un très bon connaisseur du dossier. La banque aurait touché, selon la presse américaine, entre 200 et 300 millions d’euros pour cette consultation.
Rumeurs de faillite
Toute cette tambouille était-elle illégale aux yeux d’Eurostat, qui fixe la règle du jeu en matière d’endettement public ? Pas sûr. Il semble que la Commission et les Etats membres savaient parfaitement ce qui se tramait à Rome et à Athènes. Mais voilà, les règles ont changé. «Depuis 2004, on ne peut plus réduire ainsi son déficit et sa dette», explique un porte-parole de la Commission. Toujours est-il que le sujet est aujourd’hui explosif et la réputation de Goldman Sachs passablement sulfureuse pour que Eurostat décide il y a peu de diligenter une enquête en profondeur sur cette période. Pour savoir si la banque a, oui ou non, franchi la ligne jaune.
La fin de l’année 2009 vire au scénario catastrophe pour la Grèce. Les agences de notation, Fitch la première, dégradent, la signature de sa dette, à BBB +. Ce qui équivaut à un bonnet d’âne. Les marchés commencent à douter de la solidité et de la crédibilité du plan d’Athènes. L’euro décroche. Les taux d’intérêt payés par la Grèce s’envolent. Le scénario d’une faillite circule dans les salles de marché. Les traders adorent se faire peur. Goldman Sachs va bien les aider. Le lundi 25 janvier, la Grèce a rendez-vous avec le marché. Elle veut émettre pour 3 milliards d’euros d’emprunt. Une dette est un produit financier comme un autre. Un bout de papier, avec un prix (son taux de rémunération) et une échéance (la date de remboursement). Après, il vit sa vie, sur un marché, son prix évoluant au gré de l’offre et de la demande des investisseurs.
Pour aller démarcher les clients, Athènes fait appelle à une poignée de banques d’affaires. Dont, une nouvelle fois, Goldman Sachs. Leur mission ? Rassurer les acheteurs potentiels (compagnies d’assurance, fonds de pension, mais aussi hedge funds…) sur la qualité du «papier» grec. L’opération s’avère un gros succès : 25 milliards d’euros de demande, pour 8 milliards d’euros finalement émis. Tous les joueurs de la finance veulent de la dette grecque. Pour une raison simple : elle est rémunérée à un taux défiant toute concurrence : autour de 6 %.
Information bidon
C’est l’accalmie… Enfin, pendant vingt-quatre heures. Le mercredi 27 janvier, le Financial Times, la bible des opérateurs de marché, affirme que la Chine a refusé d’acheter 25 milliards d’euros d’emprunt grec, apporté en exclusivité par l’intermédiaire de… Goldman Sachs. C’est Gary Cohn, en personne, écrit le FT, qui aurait proposé le deal au Premier ministre grec. La nouvelle sème la panique. Pour les traders, Athènes est proche du gouffre puisqu’il est obligée de solliciter la Chine en direct. Athènes dément illico. Mais les investisseurs exigent immédiatement une prime de risque encore plus élevée. C’est d’autant plus étrange que tous les professionnels ont vite compris que cette information était bidon. «Aucun pays n’achète 25 milliards d’euros de dette d’un seul coup. On a tous rigolé quand on a lu ça», se souvient un banquier français. Un professionnel décrypte : «Je ne peux pas imaginer que le Financial Times n’a pas vérifié une information aussi importante auprès de Goldman Sachs. Ce qui signifie que la banque avait un intérêt à ce que ce genre de rumeur se propage même si elle est fausse.» Et pour quelle raison ? Pour faire du cash. Car quand on s’appelle Goldman Sachs, il semble qu’on ne se contente pas de toucher, d’une main droite, des commissions pour son rôle de banquier conseil auprès du gouvernement grec. Mais qu’on spécule aussi avec la main gauche contre… la Grèce.
MArché opaque
La banque reconnaît une seule chose : en même temps qu’elle conseillait le gouvernement grec, elle recommandait à ses clients (principalement des hedge funds) d’acheter du CDS (Credit default swap) grec. Qu’est ce qu’un CDS ? Un produit financier, une sorte d’assurance destinée à se prémunir contre la potentielle défaillance d’un Etat. Un bout de papier qui peut se révéler un titre hautement spéculatif. En clair, si Goldman Sachs conseille d’acheter du CDS, cela veut dire qu’elle anticipe une hausse du prix dudit CDS. Et donc qu’il y a un risque sur la Grèce. Pas très élégant, pour la première banque conseil d’Athènes. Le plus grave, c’est que Goldman Sachs est, à cette époque, un des très gros acteurs qui spéculent sur le marché du CDS contre la Grèce. En cheville avec le hedge fund américain Paulson. Celui-là même qui s’était enrichi lors de la crise des subprimes. «C’est une règle éthique de notre métier, assure un banquier européen, on ne peut pas à la fois être rémunéré pour aider un gouvernement et spéculer sur les CDS de la dette du pays. Et pourtant il semble bien que Goldman Sachs le fait.»
Le hic c’est qu’il est impossible de le prouver. Car le marché du CDS est totalement opaque et non réglementé. Et quand on pose la question à un porte-parole de Goldman Sachs, c’est toujours la même réponse : «no comment.» Une chose est sûre : la fausse information du FT a fait les affaires de la banque, en créant un climat propice à la spéculation. Selon le bon vieil adage «on achète à la rumeur et on vend aux faits», Goldman Sachs a spéculé contre l’euro. D’après les autorités américaines, entre le 26 janvier et le 2 février, des fonds spéculatifs et des banques d’investissements (dont Goldman Sachs) ont vendu massivement des euros contre des dollars. Ils ont liquidé 43 741 contrats en euros, soit environ 5,5 milliards d’euros, c’est-à-dire autant de contrats qu’en septembre 2008, au plus fort de la crise. Bref, la banque américaine aurait gagné sur tous les tableaux.
tentation du complot
Malgré nos demandes répétées auprès de la banque, il a été impossible d’avoir des réponses précises à nos questions. Même la plus banale. Un organigramme des opérations de Goldman Sachs en Europe ? «Il n’existe pas». Une vraie boîte noire aux procédures de fer. D’autres personnalités parlent pour elle. Mais masquée. Ainsi, le 15 février, en pleine tempête contre la Grèce, Otmar Issing (lire ci dessous), ancien « chief economist » de la Banque centrale européenne, signe une tribune dans le Financial Times (encore lui). Il estime que les partenaires de la Grèce ne doivent pas voler à son secours. Cet honorable banquier central, ancien de la Bundesbank, signe son papier comme ancien de la BCE et président du Centre for Financial Studies. Il oublie délicatement de préciser qu’il est aussi conseiller international de… Goldman Sachs. Une nouvelle illustration du double jeu de la banque.
Faut-il alors céder à la tentation du «complot» anglo-saxon, piloté en majeure partie par Goldman Sachs, contre la zone euro ? Pas au sens où il s’agirait d’une attaque coordonnée et planifiée. Comme on le dit au sein du gouvernement français : «Ils font de l’argent, rien de personnel là-dedans.» Cela étant, «beaucoup d’économistes et d’opérateurs de marchés anglo-saxons sont ravis de ce qui arrive, analyse un haut fonctionnaire français, ils ont un sentiment de revanche : après l’effondrement du modèle libéral américain, les problèmes de la zone euro sont une divine surprise.» Et évidemment pour les profits et les bonus des banquiers de Goldman Sachs.
Jean QUATREMER BRUXELLES (UE), de notre correspondant et Grégoire BISEAU
Et si Michael Moore, et son film Capitalism : a Love Story, était bien en deçà de la réalité ? Et si le fleuron des «banksters», le surnom que Main street, l’homme de la rue, donne depuis la crise aux banquiers de Wall Street, était au cœur d’une affaire de subprimes étatique en Europe ? Goldman Sachs, la banque la plus puissante du monde, a spéculé sur le dos de la Grèce tout en se faisant rémunérer par Athènes pour l’aider à gérer sa dette. Voilà l’accusation qui trotte dans la tête de tous les banquiers européens. Et même au-delà. Fait rarissime, les politiques sont montés au créneau pour mettre en doute l’intégrité de la pieuvre Goldman Sachs. Sans jamais la nommer, la chancelière allemande Angela Merkel a dégainé la première mercredi. Elle juge «scandaleux» que certaines banques aient pu aider à maquiller le déficit budgétaire de la Grèce et provoquer ainsi une crise de toute la zone euro. Le lendemain, c’est au tour de la ministre de l’Economie, Christine Lagarde de se demander si «The Firm», comme on la surnomme, avait aidé la Grèce à maquiller la réalité de sa dette. «C’est une question à laquelle on doit avoir la réponse», a-t-elle dit sur France Inter. Ce n’est pas la seule. La banque américaine aux 13,3 milliards de dollars de bénéfice en 2009 est de tous les conflits d’intérêts potentiels dans cette crise grecque. A la fois conseiller et spéculateur. Bref le pire visage de la finance mondialisée…
Destination Athènes
Nous sommes début novembre 2009. Le nouveau gouvernement socialiste de George Papandreou s’arrache les cheveux. Comment convaincre les marchés et Bruxelles qu’il pourra bien tenir son programme d’austérité pour réduire une dette abyssale (112 %du PIB) ? La situation semble intenable. C’est à cette date, raconte le New York Times, qu’une délégation de banquiers de Goldman Sachs emmenée par leur numéro 2, Gary Cohn, débarque à Athènes. Nos chers banquiers ont pris rendez-vous pour présenter leur dernière petite merveille : «Un instrument financier permettant de remettre à un avenir très lointain le coût de système de santé du pays.» Et donc permettre à Athènes de se redonner un peu d’air. Goldman Sachs se sent ici un peu chez elle. Gary Cohn aurait rencontré au moins à deux reprises le Premier ministre grec. Cette proximité n’étonne personne. «Cela fait partie de la culture de la finance américaine et particulièrement de Goldman Sachs d’entretenir un contact direct avec les chefs d’Etat ou leur ministre des finances», raconte un banquier européen. L’ex-institution d’Henry Paulson, le secrétaire d’Etat au Trésor de George Bush, connaît très bien toutes les subtilités de la dette grecque. Il en fait une spécialité. «Goldman ne s’intéresse pas au marché de la dette des grands pays comme la France ou l’Allemagne, il préfère celle des petits, comme la Grèce ou le Portugal, car elle est plus volatile et donc plus spéculative, assure un responsable de la dette d’un pays européen. C’est beaucoup plus facile de se faire de l’argent vite». Et plus discrètement.
Déjà, entre 2001 et 2004, Goldman Sachs se retrouve à la manœuvre pour aider les Grecs à camoufler leur dette. Comment ? De deux façons distinctes. D’abord, grâce à des swaps de change. Des swaps, késako ? Quand un pays vend sa dette au marché, il a la possibilité d’émettre des obligations en euros ou libellées dans une autre monnaie. Pour se couvrir contre le risque de change, le gouvernement en question a recours à des instruments financiers (les fameux swaps). Jusque-là, rien que de très normal. Plusieurs pays ont utilisé ce type de technique, assez basique. Là où l’affaire se complique, et peut se révéler, pour le coup, illégale aux yeux de la Commission européenne, c’est que le gouvernement et sa banque conseil peuvent décider de changer en cours de route la parité du taux de change de leur couverture. Sans en avertir personne. Et donc d’améliorer - artificiellement - la valeur de leur dette. L’autre astuce, c’est d’anticiper des recettes futures. C’est ce qu’aurait recommandé Goldman Sachs au gouvernement conservateur de l’époque en «anticipant notamment le versement des redevances d’aéroport, pour lui permettre de faire baisser sa dette d’un montant de 0,5 % point de PIB», selon un très bon connaisseur du dossier. La banque aurait touché, selon la presse américaine, entre 200 et 300 millions d’euros pour cette consultation.
Rumeurs de faillite
Toute cette tambouille était-elle illégale aux yeux d’Eurostat, qui fixe la règle du jeu en matière d’endettement public ? Pas sûr. Il semble que la Commission et les Etats membres savaient parfaitement ce qui se tramait à Rome et à Athènes. Mais voilà, les règles ont changé. «Depuis 2004, on ne peut plus réduire ainsi son déficit et sa dette», explique un porte-parole de la Commission. Toujours est-il que le sujet est aujourd’hui explosif et la réputation de Goldman Sachs passablement sulfureuse pour que Eurostat décide il y a peu de diligenter une enquête en profondeur sur cette période. Pour savoir si la banque a, oui ou non, franchi la ligne jaune.
La fin de l’année 2009 vire au scénario catastrophe pour la Grèce. Les agences de notation, Fitch la première, dégradent, la signature de sa dette, à BBB +. Ce qui équivaut à un bonnet d’âne. Les marchés commencent à douter de la solidité et de la crédibilité du plan d’Athènes. L’euro décroche. Les taux d’intérêt payés par la Grèce s’envolent. Le scénario d’une faillite circule dans les salles de marché. Les traders adorent se faire peur. Goldman Sachs va bien les aider. Le lundi 25 janvier, la Grèce a rendez-vous avec le marché. Elle veut émettre pour 3 milliards d’euros d’emprunt. Une dette est un produit financier comme un autre. Un bout de papier, avec un prix (son taux de rémunération) et une échéance (la date de remboursement). Après, il vit sa vie, sur un marché, son prix évoluant au gré de l’offre et de la demande des investisseurs.
Pour aller démarcher les clients, Athènes fait appelle à une poignée de banques d’affaires. Dont, une nouvelle fois, Goldman Sachs. Leur mission ? Rassurer les acheteurs potentiels (compagnies d’assurance, fonds de pension, mais aussi hedge funds…) sur la qualité du «papier» grec. L’opération s’avère un gros succès : 25 milliards d’euros de demande, pour 8 milliards d’euros finalement émis. Tous les joueurs de la finance veulent de la dette grecque. Pour une raison simple : elle est rémunérée à un taux défiant toute concurrence : autour de 6 %.
Information bidon
C’est l’accalmie… Enfin, pendant vingt-quatre heures. Le mercredi 27 janvier, le Financial Times, la bible des opérateurs de marché, affirme que la Chine a refusé d’acheter 25 milliards d’euros d’emprunt grec, apporté en exclusivité par l’intermédiaire de… Goldman Sachs. C’est Gary Cohn, en personne, écrit le FT, qui aurait proposé le deal au Premier ministre grec. La nouvelle sème la panique. Pour les traders, Athènes est proche du gouffre puisqu’il est obligée de solliciter la Chine en direct. Athènes dément illico. Mais les investisseurs exigent immédiatement une prime de risque encore plus élevée. C’est d’autant plus étrange que tous les professionnels ont vite compris que cette information était bidon. «Aucun pays n’achète 25 milliards d’euros de dette d’un seul coup. On a tous rigolé quand on a lu ça», se souvient un banquier français. Un professionnel décrypte : «Je ne peux pas imaginer que le Financial Times n’a pas vérifié une information aussi importante auprès de Goldman Sachs. Ce qui signifie que la banque avait un intérêt à ce que ce genre de rumeur se propage même si elle est fausse.» Et pour quelle raison ? Pour faire du cash. Car quand on s’appelle Goldman Sachs, il semble qu’on ne se contente pas de toucher, d’une main droite, des commissions pour son rôle de banquier conseil auprès du gouvernement grec. Mais qu’on spécule aussi avec la main gauche contre… la Grèce.
MArché opaque
La banque reconnaît une seule chose : en même temps qu’elle conseillait le gouvernement grec, elle recommandait à ses clients (principalement des hedge funds) d’acheter du CDS (Credit default swap) grec. Qu’est ce qu’un CDS ? Un produit financier, une sorte d’assurance destinée à se prémunir contre la potentielle défaillance d’un Etat. Un bout de papier qui peut se révéler un titre hautement spéculatif. En clair, si Goldman Sachs conseille d’acheter du CDS, cela veut dire qu’elle anticipe une hausse du prix dudit CDS. Et donc qu’il y a un risque sur la Grèce. Pas très élégant, pour la première banque conseil d’Athènes. Le plus grave, c’est que Goldman Sachs est, à cette époque, un des très gros acteurs qui spéculent sur le marché du CDS contre la Grèce. En cheville avec le hedge fund américain Paulson. Celui-là même qui s’était enrichi lors de la crise des subprimes. «C’est une règle éthique de notre métier, assure un banquier européen, on ne peut pas à la fois être rémunéré pour aider un gouvernement et spéculer sur les CDS de la dette du pays. Et pourtant il semble bien que Goldman Sachs le fait.»
Le hic c’est qu’il est impossible de le prouver. Car le marché du CDS est totalement opaque et non réglementé. Et quand on pose la question à un porte-parole de Goldman Sachs, c’est toujours la même réponse : «no comment.» Une chose est sûre : la fausse information du FT a fait les affaires de la banque, en créant un climat propice à la spéculation. Selon le bon vieil adage «on achète à la rumeur et on vend aux faits», Goldman Sachs a spéculé contre l’euro. D’après les autorités américaines, entre le 26 janvier et le 2 février, des fonds spéculatifs et des banques d’investissements (dont Goldman Sachs) ont vendu massivement des euros contre des dollars. Ils ont liquidé 43 741 contrats en euros, soit environ 5,5 milliards d’euros, c’est-à-dire autant de contrats qu’en septembre 2008, au plus fort de la crise. Bref, la banque américaine aurait gagné sur tous les tableaux.
tentation du complot
Malgré nos demandes répétées auprès de la banque, il a été impossible d’avoir des réponses précises à nos questions. Même la plus banale. Un organigramme des opérations de Goldman Sachs en Europe ? «Il n’existe pas». Une vraie boîte noire aux procédures de fer. D’autres personnalités parlent pour elle. Mais masquée. Ainsi, le 15 février, en pleine tempête contre la Grèce, Otmar Issing (lire ci dessous), ancien « chief economist » de la Banque centrale européenne, signe une tribune dans le Financial Times (encore lui). Il estime que les partenaires de la Grèce ne doivent pas voler à son secours. Cet honorable banquier central, ancien de la Bundesbank, signe son papier comme ancien de la BCE et président du Centre for Financial Studies. Il oublie délicatement de préciser qu’il est aussi conseiller international de… Goldman Sachs. Une nouvelle illustration du double jeu de la banque.
Faut-il alors céder à la tentation du «complot» anglo-saxon, piloté en majeure partie par Goldman Sachs, contre la zone euro ? Pas au sens où il s’agirait d’une attaque coordonnée et planifiée. Comme on le dit au sein du gouvernement français : «Ils font de l’argent, rien de personnel là-dedans.» Cela étant, «beaucoup d’économistes et d’opérateurs de marchés anglo-saxons sont ravis de ce qui arrive, analyse un haut fonctionnaire français, ils ont un sentiment de revanche : après l’effondrement du modèle libéral américain, les problèmes de la zone euro sont une divine surprise.» Et évidemment pour les profits et les bonus des banquiers de Goldman Sachs.
Jean QUATREMER BRUXELLES (UE), de notre correspondant et Grégoire BISEAU
Tout mettre sur le dos du peuple grecque c'est fort de café....
Et avant de parlé dans le vide regardé le documentaire de février qui est passé sur arte.
Big brother is watching you
- Bibpanda
- Rédacteur

- Messages: 50933
- Enregistré le: 24 Déc 2005, 19:11
Re: Actu politico-politique
iamaseb, C'est donc ce que Thør a dit, alors on aurait du les laisser dans la merde, refusé dès le départ une quelconque aide, et les sortir de l'Europe pour ne pas avoir à relayer d'autres aides derrière.
C'est comme ça que tu vois les choses donc ? Ils se seraient démerdé de faire payer les riches pour rétablir un fonctionnement rationnel et efficace.
C'est comme ça que tu vois les choses donc ? Ils se seraient démerdé de faire payer les riches pour rétablir un fonctionnement rationnel et efficace.
“Sometimes, the only choices you have are bad ones, but you still have to choose.”
“Nothing’s sad until it’s over, and then everything is.”

“Nothing’s sad until it’s over, and then everything is.”

-

Jester - Fast Reply

- Messages: 85945
- Enregistré le: 13 Jan 2002, 03:12
- Localisation: Dans mon TARDIS
Re: Actu politico-politique
http://www.tagtele.com/videos/voir/92920/
documentaire aussi à voir pour ne pas mourir con et pour surtout ne pas se tromper d'ennemi qui n'est pas le peuple grecque.
documentaire aussi à voir pour ne pas mourir con et pour surtout ne pas se tromper d'ennemi qui n'est pas le peuple grecque.
Big brother is watching you
- Bibpanda
- Rédacteur

- Messages: 50933
- Enregistré le: 24 Déc 2005, 19:11
Re: Actu politico-politique
Non mais Iamaseb tu comprends bien que tomber à chaque fois dans la vieille rengaine du "fuck les banksters" permet pas franchement de trouver un compromis raisonnable. La solution elle ne se trouve ni dans ta proposition fantasque de prêt gratuit, ni dans la saignée du peuple grec. Entre les deux, il y a un large éventail de propositions pragmatiques.
- Marché Baila
- Banni

- Messages: 984
- Enregistré le: 13 Jan 2012, 16:51
Re: Actu politico-politique
Sauf que c'est déjà décidé et que la troïka est en train de tout liquider en faveur du privé et personne ne bouge, cela ne choque personne que les règles du Fmi ont été changé et que des anciens de Goldman and sachs noyautent la bce et le fmi....
Big brother is watching you
- Bibpanda
- Rédacteur

- Messages: 50933
- Enregistré le: 24 Déc 2005, 19:11
Re: Actu politico-politique
Jester , "on" c'est qui ? Avec ce "on", tu te représente les choses de cette façon :
"on" serait un acteur externe, indivisible, qui n'a rien à voir avec le sort de la Grèce. Par symétrie, la Grèce serait un autre acteur, indivisible lui aussi, qui serait responsable de sa situation.
Je pense que ce n'est pas une représentation fidèle de la réalité.
Parlons plutôt de quoi. C'est quoi qui explique la mauvaise situation de la Grèce ?
- Les intérêts privés, égoïstes. De la part des créanciers, mais aussi des individus lambdas (fraude...).
- La crise financière
- Les dettes des banques privés, transformées en dette publiques pour sauver les banques Européennes.
- Un système fiscal défaillant
- Un système inégalitaire (le capitalisme libéral pour le nommer), donc globalisé.
...
Chaque point étant lié les uns aux autres.
Le problème est donc global. Il est à la fois inhérent à l'Homme, à notre système économique globalisé, mais aussi, à une certaine spécificité Grec.
Beaucoup de pays souffrent des mêmes maux : pauvreté, dette, inégalité... ce n'est pas spécifique à la Grèce.
Donc, au lieu "d'aider" la Grèce, on (au sens citoyen du monde) aurait pu redistribuer les cartes et nous atteler au pourquoi. S'apercevoir que la notion même de dette, qui nous touche tous, est inhérente à notre système économique et qu'il s'agit d'un outil d'oppression plus qu'autre chose. On (tjs au sens citoyen du monde) aurait pu privilégié les êtres humains plutôt que les comptes en banques...
Sauf que ce "on" là, il n'a rien fait. On a laissé faire une minorité d’individu, certes nos représentants, encore que, visiblement certains ne sont même pas élus, voir "indépendant" du vote démocratique, décider du sort des Grecs, comme ils s'occupent de nous.
"on" serait un acteur externe, indivisible, qui n'a rien à voir avec le sort de la Grèce. Par symétrie, la Grèce serait un autre acteur, indivisible lui aussi, qui serait responsable de sa situation.
Je pense que ce n'est pas une représentation fidèle de la réalité.
Parlons plutôt de quoi. C'est quoi qui explique la mauvaise situation de la Grèce ?
- Les intérêts privés, égoïstes. De la part des créanciers, mais aussi des individus lambdas (fraude...).
- La crise financière
- Les dettes des banques privés, transformées en dette publiques pour sauver les banques Européennes.
- Un système fiscal défaillant
- Un système inégalitaire (le capitalisme libéral pour le nommer), donc globalisé.
...
Chaque point étant lié les uns aux autres.
Le problème est donc global. Il est à la fois inhérent à l'Homme, à notre système économique globalisé, mais aussi, à une certaine spécificité Grec.
Beaucoup de pays souffrent des mêmes maux : pauvreté, dette, inégalité... ce n'est pas spécifique à la Grèce.
Donc, au lieu "d'aider" la Grèce, on (au sens citoyen du monde) aurait pu redistribuer les cartes et nous atteler au pourquoi. S'apercevoir que la notion même de dette, qui nous touche tous, est inhérente à notre système économique et qu'il s'agit d'un outil d'oppression plus qu'autre chose. On (tjs au sens citoyen du monde) aurait pu privilégié les êtres humains plutôt que les comptes en banques...
Sauf que ce "on" là, il n'a rien fait. On a laissé faire une minorité d’individu, certes nos représentants, encore que, visiblement certains ne sont même pas élus, voir "indépendant" du vote démocratique, décider du sort des Grecs, comme ils s'occupent de nous.
L'arbre est mort, impuissant mais lucides, nous regardons les feuilles tomber, les unes après les autres.
- iamaseb
- Habituel

- Messages: 8938
- Enregistré le: 14 Fév 2003, 22:05
Re: Actu politico-politique
Marcia Baila a écrit:Non mais Iamaseb tu comprends bien que tomber à chaque fois dans la vieille rengaine du "fuck les banksters" permet pas franchement de trouver un compromis raisonnable. La solution elle ne se trouve ni dans ta proposition fantasque de prêt gratuit, ni dans la saignée du peuple grec. Entre les deux, il y a un large éventail de propositions pragmatiques.
Il y a des banquiers très bien. Tu généralises mon propos que tu qualifies de vieille rengaine pour le rendre irraisonnable.
Je ne souhaite pas personnaliser le débat aux seuls banquiers. Je dis juste que celui qui veut profiter de la misère de l'autre pour s'enrichir, ne l'aide aucunement, qu'il soit banquier, notable, prêtre,citoyen, écolier...
Et que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui.
L'arbre est mort, impuissant mais lucides, nous regardons les feuilles tomber, les unes après les autres.
- iamaseb
- Habituel

- Messages: 8938
- Enregistré le: 14 Fév 2003, 22:05
Re: Actu politico-politique
iamaseb, "on" c'est nous, c'est l'Europe. Quand l'Europe a défini des règles, c'était pour qu'on s'y tienne, quand elle s'est formée, c'était pour que les efforts, les richesses, et les dettes soient plu supportable car à plusieurs on avance mieux que seul.
“Sometimes, the only choices you have are bad ones, but you still have to choose.”
“Nothing’s sad until it’s over, and then everything is.”

“Nothing’s sad until it’s over, and then everything is.”

-

Jester - Fast Reply

- Messages: 85945
- Enregistré le: 13 Jan 2002, 03:12
- Localisation: Dans mon TARDIS
Re: Actu politico-politique
Les règles ont été changé plusieurs fois, le non à la constitution qui fut ratifié sans notre consentement, tu trouves ça normal aussi ? Que ce sont des gens non élus qui décident des directives qu'ils imposent au peuple c est normal aussi....
Big brother is watching you
- Bibpanda
- Rédacteur

- Messages: 50933
- Enregistré le: 24 Déc 2005, 19:11
Re: Actu politico-politique
Je n'ai pas dit que c'était normal. Juste iamaseb part du principe, comme toi, que la Grèce a payé à cause de l'Europe, et qu'on aurait du les laisser faire sans aide plutôt que de foutre les pauvres à la rue.
“Sometimes, the only choices you have are bad ones, but you still have to choose.”
“Nothing’s sad until it’s over, and then everything is.”

“Nothing’s sad until it’s over, and then everything is.”

-

Jester - Fast Reply

- Messages: 85945
- Enregistré le: 13 Jan 2002, 03:12
- Localisation: Dans mon TARDIS
Re: Actu politico-politique
Je crois que la Grèce n' a jamais été un peuple de riches, à ^part quelques armateurs et autres , plus des politiciens véreux .
Sans doute que peu d' entre vous ici se souviennent de Mélina Mercouri, grande actrice Grècque, qui avait épousé Jules Dassin et après sa carrière avait été élue au parlement grec . Déjà, à cette époque, elle avait renoncé à ses émoluments car le pays allait mal ....
Sans doute que peu d' entre vous ici se souviennent de Mélina Mercouri, grande actrice Grècque, qui avait épousé Jules Dassin et après sa carrière avait été élue au parlement grec . Déjà, à cette époque, elle avait renoncé à ses émoluments car le pays allait mal ....
" L’équité, c’est une certaine logique, du bon sens, alors que l’égalité est impossible, dans le football." Pape Diouf 

-

jarlandine - Floodeur pro

- Messages: 24141
- Enregistré le: 28 Mar 2011, 13:00
- Localisation: 04
Re: Actu politico-politique
Jester a écrit:iamaseb, "on" c'est nous, c'est l'Europe. Quand l'Europe a défini des règles, c'était pour qu'on s'y tienne, quand elle s'est formée, c'était pour que les efforts, les richesses, et les dettes soient plu supportable car à plusieurs on avance mieux que seul.
L'Europe ne défini pas de règles. C'est des Hommes qui définissent des règles. Et les choix effectués par ces Hommes sont par nature politique. Donc l'Europe, on peut l'utiliser pour diverses fins. Cela peut-être l'amélioration du train de vie des plus démunis, comme l'ouverture d'un vaste marché pour profiter aux mieux des disparités et donc de la précarité des Européens.
Tant que l'Europe préférera lutter contre les services publiques plutôt que de sanctionner économiquement les pays riches pour les inégalités au sein de leur population, elle restera pour moi un outil au main d'une minorité cherchant leur propre intérêt.
L'arbre est mort, impuissant mais lucides, nous regardons les feuilles tomber, les unes après les autres.
- iamaseb
- Habituel

- Messages: 8938
- Enregistré le: 14 Fév 2003, 22:05
Re: Actu politico-politique
Jester a écrit:Je n'ai pas dit que c'était normal. Juste iamaseb part du principe, comme toi, que la Grèce a payé à cause de l'Europe, et qu'on aurait du les laisser faire sans aide plutôt que de foutre les pauvres à la rue.
J'ai expliqué les causes juste avant.
- Les intérêts privés, égoïstes. De la part des créanciers, mais aussi des individus lambdas (fraude...).
- La crise financière
- Les dettes des banques privés, transformées en dette publiques pour sauver les banques Européennes.
- Un système fiscal défaillant
- Un système inégalitaire (le capitalisme libéral pour le nommer), donc globalisé.
...
Comme je l'ai dit, si il y a des spécificités liés a la Grèce, le problème de fond reste plus systémique.
Sinon, oui, par principe foutre les pauvres et les non encore pauvres à la rue n'est pas une solution, et encore moins une aide.
L'arbre est mort, impuissant mais lucides, nous regardons les feuilles tomber, les unes après les autres.
- iamaseb
- Habituel

- Messages: 8938
- Enregistré le: 14 Fév 2003, 22:05
Re: Actu politico-politique
Bah moi je vois sous un autre angle que toi. C'est que sans aide (prêt initial) à la Grèce, "tes" pauvres, ils étaient directs à la rue, alors qu'ils ne le sont pas actuellement. La Grèce serait hors de l'Europe. L'Europe aurait perdu de ce fait son rôle principal et de base, et donc aurait eu des soucis pour poursuivre tout court, car incapable de protéger les pays qui la compose, etc.
La Grèce enfin aurait eu une monnaie qui ne vaudrait plus rien du tout et ne pourrait plus avoir de prêt car insolvable, et à des taux impossible à tenir.
La Grèce enfin aurait eu une monnaie qui ne vaudrait plus rien du tout et ne pourrait plus avoir de prêt car insolvable, et à des taux impossible à tenir.
“Sometimes, the only choices you have are bad ones, but you still have to choose.”
“Nothing’s sad until it’s over, and then everything is.”

“Nothing’s sad until it’s over, and then everything is.”

-

Jester - Fast Reply

- Messages: 85945
- Enregistré le: 13 Jan 2002, 03:12
- Localisation: Dans mon TARDIS
Re: Actu politico-politique
Le nombre de pauvres a explosé, le nombre de sans abris aussi, l'Europe se déchire, une part de plus en plus important des populations méprise les peuples voisins, les partis d'extrême droite montent donc partout en Europe, la Grèce se fait prêter sous des conditions intenables.
C'est le bilan factuel.
C'est le bilan factuel.
L'arbre est mort, impuissant mais lucides, nous regardons les feuilles tomber, les unes après les autres.
- iamaseb
- Habituel

- Messages: 8938
- Enregistré le: 14 Fév 2003, 22:05
Re: Actu politico-politique
Donc supprimons l'Europe. Chaque pays retrouvera sa liberté. Gérera tout seul ses intérêts, sa monnaie, ses dettes,... Et surtout l'extrême droite en sortira grandie vu que c'est ce qu'elle prône.
Marine en 2017... huuuuuum.

Marine en 2017... huuuuuum.

“Sometimes, the only choices you have are bad ones, but you still have to choose.”
“Nothing’s sad until it’s over, and then everything is.”

“Nothing’s sad until it’s over, and then everything is.”

-

Jester - Fast Reply

- Messages: 85945
- Enregistré le: 13 Jan 2002, 03:12
- Localisation: Dans mon TARDIS
Re: Actu politico-politique
Jester, l'extrême droite avait moins de pouvoir et de partisans quand l'UE n'existait pas 

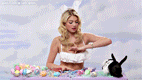
Si l'homme est l’œuvre de dieu, alors les religions sont celles du diable.
-

dlb1664 - Des seins animés addict

- Messages: 41571
- Enregistré le: 17 Juin 2005, 13:05
- Localisation: Jura Sick Park
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Kim Nielsen et 74 invités
