Series Tv
Modérateur: Modérateurs
Re: Series Tv
Iron Fist aurait pu être bien si ça avait été mieux réalisé et mieux joué.
regarde la localisation
-

sillicate - Minet râle

- Messages: 29829
- Enregistré le: 07 Jan 2005, 16:54
- Localisation: pizzeria
Re: Series Tv
J'ai terminé Versailles de Canal+, ça se laisse regarder, par contre ils prennent un peu beaucoup de libertés avec la version officielle j'ai l'impression, et je trouve également que les 2 derniers épisodes sont un peu bâclés comme s'ils avaient du tout caser dans ceux là pour vite finir le truc ...

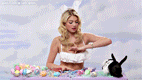
Si l'homme est l’œuvre de dieu, alors les religions sont celles du diable.
-

dlb1664 - Des seins animés addict

- Messages: 41571
- Enregistré le: 17 Juin 2005, 13:05
- Localisation: Jura Sick Park
Re: Series Tv
dlb1664, ouais comme tu dis ça se laisse regarder même si ça casse pas des briques. Et oui c'est pas des largesses qu'ils prennent sur l'Histoire, c'est des gouffres. 
Mais ça a été assumé dès le départ.
Mais ça a été assumé dès le départ.
La médiocrité commence là où les passions meurent.
-

Fennec - coupé grandes oreilles

- Messages: 34020
- Enregistré le: 08 Avr 2009, 16:13
- Localisation: RP
Re: Series Tv
Dragan a écrit:Homeland a Remonté la pente sur les derniers épisodes après un début de saison cata
Par contre on est passé encore à un tout autre show. Maintenant après 24 c'est devenu un concurrent de Designated Survivor
Moi, elle m'a frustré cette saison de Homeland. Départ treès lent il est vrai, mais aprerès, l'intrigue est vraiment intéressante.
Mais la fin de saion arrive beaucoup trop vite et surtout, toute l'intrigue tombe dans l'eau au dernier épisode.
Alors certes, cet episode mene vers un e intrigue intéressante aussi, mais elle gache toute cette saison
Le président de Nantes, Waldemar Kita, se pose des questions : «Qu'a-t-il déjà réalisé dans sa vie pour donner de telles leçons ? C'est de la malhonneteté intellectuelle. S'il continue ainsi, Bielsa n'ira pas loin.» 09/09/14
-

Kaveen - Habituel

- Messages: 7893
- Enregistré le: 01 Fév 2003, 03:03
- Localisation: Arcachon 33
Re: Series Tv
Kaveen, je t'invite a lire cet article de Telerama sur cette saison de Homeland avec lequel je suis assez d'accord:
http://linkis.com/www.telerama.fr/seri/1E1Xh
Je comprenais rien a ses 3-4 premiers episodes que je trouvais merdiques a souhait avant en effet de voir la montee en puissance derriere.
Meme si ca n'a plus rien a voir avec l'idee originelle de la serie, j'ai bien aime la maniere dont ils ont construit la 2e partie de la saison
http://linkis.com/www.telerama.fr/seri/1E1Xh
Spoiler: montrer
Je comprenais rien a ses 3-4 premiers episodes que je trouvais merdiques a souhait avant en effet de voir la montee en puissance derriere.
Meme si ca n'a plus rien a voir avec l'idee originelle de la serie, j'ai bien aime la maniere dont ils ont construit la 2e partie de la saison
Samba / Renan Lodi, Lacroix, Mbemba, Clauss / Lemar, Kondogbia, Guendouzi, Is. Sarr / Alexis, Aubameyang
Blanco / J. Firpo, Gigot, Seidu, R. Pereira / Harit, Soumaré, Ounahi, Mughe/ Ndiaye, Vitinha
Ventes : Touré, Balerdi, Lopez, Rongier, Veretout, Amavi, Lirola
Blanco / J. Firpo, Gigot, Seidu, R. Pereira / Harit, Soumaré, Ounahi, Mughe/ Ndiaye, Vitinha
Ventes : Touré, Balerdi, Lopez, Rongier, Veretout, Amavi, Lirola
-

Dragan - Rédacteur

- Messages: 78743
- Enregistré le: 11 Mar 2007, 14:09
- Localisation: En territoire ennemi
Re: Series Tv
Viens de me mater le premier épisode de la saison 10 du Docteur. 


“Sometimes, the only choices you have are bad ones, but you still have to choose.”
“Nothing’s sad until it’s over, and then everything is.”

“Nothing’s sad until it’s over, and then everything is.”

-

Jester - Fast Reply

- Messages: 86394
- Enregistré le: 13 Jan 2002, 03:12
- Localisation: Dans mon TARDIS
Re: Series Tv
Jester, j'ai kiffé aussi, c'était formidable.
«On a fait une erreur dans ce mercato, c'est d'avoir eu des discussions avec un joueurs qui ont trop duré. Et ça, c'est une erreur qu'on essaiera de ne pas reproduire» 

-

boodream - Poète nain

- Messages: 57490
- Enregistré le: 29 Mai 2004, 16:43
Re: Series Tv
La nouvelle saison de Fargo toujours au niveau des 2 précédentes pour le moment 
J'adore cette ambiance tout se joue sur des quiproquos vraiment excellent, et puis Mary Elizabeth Winstead

J'adore cette ambiance tout se joue sur des quiproquos vraiment excellent, et puis Mary Elizabeth Winstead

Spoiler: montrer

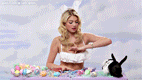
Si l'homme est l’œuvre de dieu, alors les religions sont celles du diable.
-

dlb1664 - Des seins animés addict

- Messages: 41571
- Enregistré le: 17 Juin 2005, 13:05
- Localisation: Jura Sick Park
Re: Series Tv
Bibpanda, si apparemment, mais j'ai pas encore regardé ça.

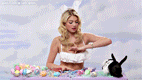
Si l'homme est l’œuvre de dieu, alors les religions sont celles du diable.
-

dlb1664 - Des seins animés addict

- Messages: 41571
- Enregistré le: 17 Juin 2005, 13:05
- Localisation: Jura Sick Park
Re: Series Tv
Je me suis mis en mode Slowpoke à Black Mirror. Mon dieu quelle tuerie. Pour l'instant j'ai juste été déçu par le s02e02, je trouve qu'il y a un peu trop de messages envoyés et ça a tendance à noyer un peu le truc.
Mais putain rien que le pilote quoi, quelle claque.
Mais putain rien que le pilote quoi, quelle claque.
La médiocrité commence là où les passions meurent.
-

Fennec - coupé grandes oreilles

- Messages: 34020
- Enregistré le: 08 Avr 2009, 16:13
- Localisation: RP
Samba / Renan Lodi, Lacroix, Mbemba, Clauss / Lemar, Kondogbia, Guendouzi, Is. Sarr / Alexis, Aubameyang
Blanco / J. Firpo, Gigot, Seidu, R. Pereira / Harit, Soumaré, Ounahi, Mughe/ Ndiaye, Vitinha
Ventes : Touré, Balerdi, Lopez, Rongier, Veretout, Amavi, Lirola
Blanco / J. Firpo, Gigot, Seidu, R. Pereira / Harit, Soumaré, Ounahi, Mughe/ Ndiaye, Vitinha
Ventes : Touré, Balerdi, Lopez, Rongier, Veretout, Amavi, Lirola
-

Dragan - Rédacteur

- Messages: 78743
- Enregistré le: 11 Mar 2007, 14:09
- Localisation: En territoire ennemi
Re: Series Tv
Fennec a écrit:Pour l'instant j'ai juste été déçu par le s02e02, je trouve qu'il y a un peu trop de messages envoyés et ça a tendance à noyer un peu le truc.
Ben c'est un peu tous les épisodes qui nous renvoient à notre utilisation des réseaux sociaux et de la dérive qui pourrait en découler dans nos sociétés futures, qu'est-ce que tu as trouvé de plus choquant dans cet épisode (La chasse, je crois) que d'en d'autres ?
-

Remind - Pilier de comptoir

- Messages: 13929
- Enregistré le: 03 Avr 2006, 21:46
Re: Series Tv
Dragan, joli trailer, ça donne envie (autant que Robin Wright  )
)
-

Remind - Pilier de comptoir

- Messages: 13929
- Enregistré le: 03 Avr 2006, 21:46
Re: Series Tv
Remind, oui c'est bien La Chasse. Je sais pas, contrairement aux autres épisodes qui ont un cadre et une critique ciblée j'ai trouvé que ça voulait nous faire passer trop de messages en trop peu de temps. C'est peut-être l'introduction d'un twist qu'on avait pas vu jusque là dans la série qui m'a déstabilisé. Au final à la fin de l'épisode tu sais pas trop si tu ressens du dégoût, de la colère, de la tristesse. C'est étrange, certainement volontaire, mais différent du reste du show où les épisodes sont une espèce de montée progressive dans le sentiment de gêne, de répulsion.
La médiocrité commence là où les passions meurent.
-

Fennec - coupé grandes oreilles

- Messages: 34020
- Enregistré le: 08 Avr 2009, 16:13
- Localisation: RP
Re: Series Tv
J'ai maté le pilote de The Handmaid's Tale, ça à l'air pas mal, hâte de voir la suite pour le moment !

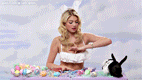
Si l'homme est l’œuvre de dieu, alors les religions sont celles du diable.
-

dlb1664 - Des seins animés addict

- Messages: 41571
- Enregistré le: 17 Juin 2005, 13:05
- Localisation: Jura Sick Park
Re: Series Tv
randoulou a écrit:Et ce prison break alors ?? Je sais pas quoi en penser pour l'instant
J'ai vu les 5 premiers épisodes. Pour les fans ça se regarde Mais alors prison break au milieu de l'état islamique c'est quand même totalement What The Fuck
Samba / Renan Lodi, Lacroix, Mbemba, Clauss / Lemar, Kondogbia, Guendouzi, Is. Sarr / Alexis, Aubameyang
Blanco / J. Firpo, Gigot, Seidu, R. Pereira / Harit, Soumaré, Ounahi, Mughe/ Ndiaye, Vitinha
Ventes : Touré, Balerdi, Lopez, Rongier, Veretout, Amavi, Lirola
Blanco / J. Firpo, Gigot, Seidu, R. Pereira / Harit, Soumaré, Ounahi, Mughe/ Ndiaye, Vitinha
Ventes : Touré, Balerdi, Lopez, Rongier, Veretout, Amavi, Lirola
-

Dragan - Rédacteur

- Messages: 78743
- Enregistré le: 11 Mar 2007, 14:09
- Localisation: En territoire ennemi
Re: Series Tv
En parlant de WTF, la nouvelle Série AMERICAN GODS ça promet aussi.
J'ai adoré le pilote !!!
J'ai adoré le pilote !!!
Le président de Nantes, Waldemar Kita, se pose des questions : «Qu'a-t-il déjà réalisé dans sa vie pour donner de telles leçons ? C'est de la malhonneteté intellectuelle. S'il continue ainsi, Bielsa n'ira pas loin.» 09/09/14
-

Kaveen - Habituel

- Messages: 7893
- Enregistré le: 01 Fév 2003, 03:03
- Localisation: Arcachon 33
Re: Series Tv
Basée sur un comics American Gods. 
Tout comme Preacher dont j'attends la S2.
Tout comme Preacher dont j'attends la S2.
regarde la localisation
-

sillicate - Minet râle

- Messages: 29829
- Enregistré le: 07 Jan 2005, 16:54
- Localisation: pizzeria
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 45 invités
