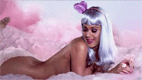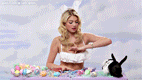Personne, il y a encore un mois, n’aurait imaginé que la Commission européenne choisirait pareille option. L’annonce, mercredi 15 juin, de sa proposition finale de réglementation des perturbateurs endocriniens a surpris tout le monde. Mais elle a surtout laissé abasourdis la plupart des acteurs impliqués dans cette saga politico-technique. Abasourdis voire accablés. Car en offrant un traitement d’exception à cette famille de polluants chimiques, la Commission exige un niveau de preuves d’effets nocifs très difficile à atteindre. Impossible, estiment même certains. Les promesses de restrictions et d’interdictions, prévues dans le règlement régissant la mise sur le marché des pesticides en Europe, ne seront peut-être tenues qu’au compte-gouttes.
Depuis plus de vingt-cinq ans, les éléments s’accumulent sur ces produits chimiques capables d’interférer avec le système hormonal (endocrinien) des êtres vivants, suscitant une sourde inquiétude dans la communauté scientifique. Constituants d’une multitude d’objets de consommation – plastiques, cosmétiques, peintures, etc. – et contaminant l’environnement, ils sont soupçonnés de contribuer à l’augmentation de nombreuses maladies : infertilité, certains cancers, développement du cerveau, etc. Tandis que l’on détecte 43 produits chimiques en moyenne dans le corps d’une femme enceinte, plusieurs études ont tenté de chiffrer le coût, pour la société, des maladies liées à une exposition aux perturbateurs endocriniens. Les estimations oscillent entre 157 et 288 milliards d’euros par an en Europe.
Personne, il y a encore un mois, n’aurait imaginé que la Commission européenne choisirait pareille option. L’annonce, mercredi 15 juin, de sa proposition finale de réglementation des perturbateurs endocriniens a surpris tout le monde. Mais elle a surtout laissé abasourdis la plupart des acteurs impliqués dans cette saga politico-technique. Abasourdis voire accablés. Car en offrant un traitement d’exception à cette famille de polluants chimiques, la Commission exige un niveau de preuves d’effets nocifs très difficile à atteindre. Impossible, estiment même certains. Les promesses de restrictions et d’interdictions, prévues dans le règlement régissant la mise sur le marché des pesticides en Europe, ne seront peut-être tenues qu’au compte-gouttes.
Depuis plus de vingt-cinq ans, les éléments s’accumulent sur ces produits chimiques capables d’interférer avec le système hormonal (endocrinien) des êtres vivants, suscitant une sourde inquiétude dans la communauté scientifique. Constituants d’une multitude d’objets de consommation – plastiques, cosmétiques, peintures, etc. – et contaminant l’environnement, ils sont soupçonnés de contribuer à l’augmentation de nombreuses maladies : infertilité, certains cancers, développement du cerveau, etc. Tandis que l’on détecte 43 produits chimiques en moyenne dans le corps d’une femme enceinte, plusieurs études ont tenté de chiffrer le coût, pour la société, des maladies liées à une exposition aux perturbateurs endocriniens. Les estimations oscillent entre 157 et 288 milliards d’euros par an en Europe.
En savoir plus sur
http://www.lemonde.fr/planete/article/2 ... EQertgy.99