Le mec a dit tout et son contraire sur le gaz de schiste en seulement deux ans.
[ -> 2013] Politique : Mutations et Enjeux
Modérateur: Modérateurs
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
Putain quelle girouette ce Montebourg... 
Le mec a dit tout et son contraire sur le gaz de schiste en seulement deux ans.
Le mec a dit tout et son contraire sur le gaz de schiste en seulement deux ans.
"Bye bye les doubles comptes sont interdits". 
Quel dommage que son copain soit arrivé à temps.
Quel dommage que son copain soit arrivé à temps.
-

killerdemars - Banni

- Messages: 25879
- Enregistré le: 16 Mai 2006, 09:25
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
Qu'on le vire 
- John
- La nonne

- Messages: 6935
- Enregistré le: 15 Déc 2005, 00:54
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
C'est facile de virer une Batho qui l'ouvre une fois mais ce tocard de montebourg qui ne fait et raconte que de la merde depuis un an...
*Vainqueur de la Champion's League OMlive 2014/2015* 
Il y a toujours un pied Ghanéen qui empêche les Allemands de trouver la solution finale. @ X. Gravelaine

Il y a toujours un pied Ghanéen qui empêche les Allemands de trouver la solution finale. @ X. Gravelaine
-

Garm - Assidu

- Messages: 3773
- Enregistré le: 24 Avr 2010, 20:15
- Localisation: Helsinki
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
Garm a écrit:C'est facile de virer une Batho qui l'ouvre une fois mais ce tocard de montebourg qui ne fait et raconte que de la merde depuis un an...
A h t'as compté un an toi, moi j'aurai dit 10, comme quoi la perception du temps
Fennec a écrit:Rennes c'est quand même le summum de la lose.
Je pense que l'univers se venge du fait que Pinault ait le droit de se taper Salma Hayek.
-

MilkyWay - Assidu

- Messages: 4020
- Enregistré le: 29 Mar 2013, 14:50
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
Information
La contribution du PCF à la campagne de dons de l’UMP
Depuis la décision du Conseil constitutionnel de rejeter les comptes de la campagne présidentielle de 2012 de Nicolas Sarkozy, le 4 juillet, c'est le branle-bas de combat à l'UMP. Le principal parti d'opposition, déjà en grave difficulté financière, doit trouver plus de 11 millions d'euros d'ici au 31 juillet. Son président, Jean-François Copé, a affirmé le 14 juillet que le parti avait reçu "près de 5 millions d'euros de dons".
Chaque euro versé permet à l'UMP de combler ce "trou". La section du Parti communiste à Oullins, dans le Rhône, a elle aussi apporté sa contribution... à sa façon.
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/ ... r=RSS-3208
Depuis la décision du Conseil constitutionnel de rejeter les comptes de la campagne présidentielle de 2012 de Nicolas Sarkozy, le 4 juillet, c'est le branle-bas de combat à l'UMP. Le principal parti d'opposition, déjà en grave difficulté financière, doit trouver plus de 11 millions d'euros d'ici au 31 juillet. Son président, Jean-François Copé, a affirmé le 14 juillet que le parti avait reçu "près de 5 millions d'euros de dons".
Chaque euro versé permet à l'UMP de combler ce "trou". La section du Parti communiste à Oullins, dans le Rhône, a elle aussi apporté sa contribution... à sa façon.
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/ ... r=RSS-3208
- John
- La nonne

- Messages: 6935
- Enregistré le: 15 Déc 2005, 00:54
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
Oh putain les bâtards 


PCF 1
UMP 0

PCF 1
UMP 0
-Vainqueur Coupe Confédération 2009 / Coupe UEFA 2008, 2015 / CdF 2012 / L1 2014
-Finaliste Mondial 2010 / Euro 2008, 2016 / CdL 2010, 2011, 2015 / CdF 2009, 2013 / L2 2012 / TdC 2012
-Finaliste Mondial 2010 / Euro 2008, 2016 / CdL 2010, 2011, 2015 / CdF 2009, 2013 / L2 2012 / TdC 2012
-

sonny - Keep on Roolin' baby

- Messages: 70727
- Enregistré le: 19 Déc 2002, 20:50
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
Vous croyez qu'ils ont demandé une déduction fiscale ?
Big brother is watching you
-

Bibpanda - Rédacteur

- Messages: 51045
- Enregistré le: 24 Déc 2005, 19:11
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
Joli 
*Vainqueur de la Champion's League OMlive 2014/2015* 
Il y a toujours un pied Ghanéen qui empêche les Allemands de trouver la solution finale. @ X. Gravelaine

Il y a toujours un pied Ghanéen qui empêche les Allemands de trouver la solution finale. @ X. Gravelaine
-

Garm - Assidu

- Messages: 3773
- Enregistré le: 24 Avr 2010, 20:15
- Localisation: Helsinki
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
lol on devrait tous donner 1euros ou 50 centimes avec l'impression du recu fiscale, l'UMP ne pourrait pas suivre mdr
-

richardB - Ménauposé

- Messages: 10130
- Enregistré le: 23 Juil 2009, 21:22
- Localisation: Entre Brest et Vladivostok
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
Je leur demanderai surtout de nous rembourser le pognon qu'ils nous ont piqué à tout ces enculés.
Big brother is watching you
-

Bibpanda - Rédacteur

- Messages: 51045
- Enregistré le: 24 Déc 2005, 19:11
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
C'est pas con l'idée de tous donner un euro et de réclamer un recu... par la poste.
Entre l'impression, le papier et le timbre
Par contre, la somme minimale c'est un euro
Entre l'impression, le papier et le timbre

Par contre, la somme minimale c'est un euro
- John
- La nonne

- Messages: 6935
- Enregistré le: 15 Déc 2005, 00:54
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
avec le timbre à 60 centimes, avec le papier et l'encre on doit pas être très loin, plus le salarié qui va faire ça, on dépasse l'euro...
-

richardB - Ménauposé

- Messages: 10130
- Enregistré le: 23 Juil 2009, 21:22
- Localisation: Entre Brest et Vladivostok
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
richardB a écrit:lol on devrait tous donner 1euros ou 50 centimes avec l'impression du recu fiscale, l'UMP ne pourrait pas suivre mdr
Il y avait eu ça pour la mairie de Paris suite à la pelouse saccagée par la manif pour tous. La mairie de Paris avait reçu un max de chèque d'1 euro mais en avait encaissé aucun pour ne pas avoir à envoyer des reçus qui couteraient plus cher que ce qu'ils ont reçu.
-Vainqueur Coupe Confédération 2009 / Coupe UEFA 2008, 2015 / CdF 2012 / L1 2014
-Finaliste Mondial 2010 / Euro 2008, 2016 / CdL 2010, 2011, 2015 / CdF 2009, 2013 / L2 2012 / TdC 2012
-Finaliste Mondial 2010 / Euro 2008, 2016 / CdL 2010, 2011, 2015 / CdF 2009, 2013 / L2 2012 / TdC 2012
-

sonny - Keep on Roolin' baby

- Messages: 70727
- Enregistré le: 19 Déc 2002, 20:50
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
Information
C'est un incroyable réquisitoire contre les anciens dirigeants de la banque Dexia qu'a dressé jeudi la Cour des comptes. Mais ils ne sont pas les seuls à être pointés du doigt dans la débâcle de l'établissement franco-belge, emporté par la crise financière. Dans leur rapport d'enquête, les magistrats de la rue de Cambon s'en prennent à tous les acteurs du dossier, de la Caisse des dépôts et consignations - actionnaire minoritaire - à l'État français, en passant par les régulateurs. Aucun d'entre eux n'a joué correctement son rôle. Bilan : une facture - encore provisoire - de... 6,6 milliards d'euros, rien que pour le contribuable français !
La Cour des comptes enfonce d'abord la défense des ex-dirigeants, selon laquelle Dexia aurait été une simple victime parmi d'autres d'une crise financière venue d'outre-Atlantique. "C'est avant tout la fragilité de son modèle, la faiblesse de sa gouvernance et les défaillances de la régulation et de la supervision qui expliquent que le groupe n'ait pas survécu aux crises de 2008 et 2011", a résumé le premier président de la Cour, le socialiste Didier Migaud, lors de la présentation du rapport.
Un conseil d'administration incompétent
D'abord le modèle de financement de la banque. Pour accorder des prêts à long terme, l'établissement franco-belge, né du rapprochement en 1996 entre le Crédit local de France et l'établissement de dépôts Crédit communal de Belgique, n'a jamais eu assez de dépôts dans son bilan. Au 31 décembre 2008, après la faillite de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers, plus d'un tiers des financements de Dexia (260 milliards d'euros sur 651 au total) sont des financements à court terme, dépendant des taux sur le marché interbancaire (où les banques se prêtent entre elles à de courtes échéances).
Ensuite, la faiblesse de la gouvernance. Au cours des années 2000, Dexia s'est engagée "dans une stratégie de croissance externe très rapide et mal maîtrisée, avec des acquisitions coûteuses, parfois hasardeuses", relève Didier Migaud. Les signaux annonciateurs de la crise, en 2007, n'ont pas été pris en compte. Le groupe, au contraire, a accéléré sa stratégie de croissance en cherchant à tirer parti des difficultés de ses concurrents. Le conseil d'administration, qui comptait peu d'experts ou de professionnels aguerris aux questions bancaires, ne s'est pas opposé à une telle stratégie qui a perduré jusqu'au milieu de l'année 2008, c'est-à-dire bien trop longtemps compte tenu de la montée des risques et de la dégradation rapide du résultat du groupe".
Une supervision éclatée
Quant à la supervision, elle n'était pas efficace, car trop éclatée entre régulateurs belges et français. Enfin, la régulation imposée aux banques (la fameuse règle de Bâle) n'a pas plus été utile pour empêcher le désastre, puisqu'elle leur permettait de se financer grâce à des obligations publiques - à l'époque considérées comme sûres - sans aucune pondération du risque.
Le premier sauvetage passe par des garanties publiques et une augmentation de capital financée par la puissance publique belge et française, sans qu'aucun effort ne soit demandé aux actionnaires existants. Un "choix critiquable", a encore jugé Didier Migaud. Et pour cause : "Les participations publiques prises, soit 2,7 milliards d'euros pour les entités publiques françaises - État et Caisse des dépôts et consignations (...) -, ont rapidement perdu la totalité de leur valeur."
C'est alors que l'État se résout finalement à devenir actionnaire direct et à mettre son nez dans la gouvernance. Mais l'accalmie de 2009-2010 n'est que de courte durée. La crise des dettes souveraines vient prendre le relais de la crise de la liquidité bancaire pour donner le coup de grâce à Dexia, qui voit sa notation dégradée à cause de son exposition aux dettes publiques du sud de l'Europe.
Des risques pendant 40 ans
Morale de l'histoire, "faute de cadre européen permettant d'organiser la disparition de Dexia sans intervention financière des États et sans impact sur les finances publiques, le schéma retenu a fait porter l'essentiel des risques passés et la totalité des risques futurs sur les États français et belge", pendant 40 ans, prévient la Cour des comptes, au travers de son premier président.
D'autant que les prêts toxiques accordés aux collectivités locales, "dont l'encours représente encore 10,5 milliards d'euros", font peser "un risque important sur le bon déroulement de la phase de gestion extinctive à venir". Les impayés des collectivités sont en effet "à un niveau modeste, mais en forte croissance"...
D'où l'importance, pour l'avenir, de la construction de l'Union bancaire européenne avec un superviseur unique dépendant de la BCE et de la mise à contribution prévue des créanciers privés au moment d'un sauvetage ou d'une mise en faillite de banque.
Des responsables impunis
Qui est responsable de cette débâcle ? Personne n'a réellement voulu aller les chercher. Au point que "la plupart des anciens dirigeants bénéficient aujourd'hui d'avantages importants, en particulier de retraites chapeaux", dénonce Didier Migaud. Certes, le président du conseil d'administration et administrateur délégué de 1999 à 2006, Pierre Richard, ainsi qu'Axel Miller, ancien administrateur délégué, ont été écartés. Mais "aucune action de mise en cause ou de recherche de la responsabilité des anciens dirigeants n'avait eu lieu à l'initiative des nouveaux dirigeants, des actionnaires ou des États avant octobre 2011. Le groupe a invoqué un risque d'image pouvant porter atteinte au bon déroulement du redressement", continue le premier président de la Cour.
Ce n'est que sous la menace d'un recours judiciaire, dont la possibilité a été relevée par la Cour lors de la préparation de son rapport, qu'a finalement eu lieu en 2012 une "négociation d'une réduction transactionnelle de la retraite de M. Pierre Richard, qui est passée de 563 000 euros annuels à 300 000 euros, montant qui n'intègre pas sa retraite de la fonction publique". Une situation qui n'a visiblement pas choqué les nouveaux dirigeants : "Le conseil d'administration s'est satisfait de cette issue et a renoncé à exercer les voies de recours", souligne Didier Migaud.
Des retraites chapeaux confortables
D'ailleurs cinq autres dirigeants jouissent toujours de leur retraite chapeau, à en croire la Cour, qui souhaite exercer un recours en justice "susceptible de réduire substantiellement les pensions de l'ensemble des bénéficiaires". Une voie judiciaire qui s'éteindra dès l'année prochaine, si rien n'est fait...
Mais même si le recours devait avoir lieu, quatre anciens dirigeants remerciés jouiraient toujours de leurs indemnités de départ, négociées en plus des indemnités classiques de licenciement. Des sommes qui représentent, selon la Cour des comptes, entre 595 000 et 765 000 euros. Confortable, en particulier pour deux d'entre eux, qui ont bénéficié d'une réintégration immédiate dans la fonction publique, dans leurs corps d'origine.
La Cour des comptes enfonce d'abord la défense des ex-dirigeants, selon laquelle Dexia aurait été une simple victime parmi d'autres d'une crise financière venue d'outre-Atlantique. "C'est avant tout la fragilité de son modèle, la faiblesse de sa gouvernance et les défaillances de la régulation et de la supervision qui expliquent que le groupe n'ait pas survécu aux crises de 2008 et 2011", a résumé le premier président de la Cour, le socialiste Didier Migaud, lors de la présentation du rapport.
Un conseil d'administration incompétent
D'abord le modèle de financement de la banque. Pour accorder des prêts à long terme, l'établissement franco-belge, né du rapprochement en 1996 entre le Crédit local de France et l'établissement de dépôts Crédit communal de Belgique, n'a jamais eu assez de dépôts dans son bilan. Au 31 décembre 2008, après la faillite de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers, plus d'un tiers des financements de Dexia (260 milliards d'euros sur 651 au total) sont des financements à court terme, dépendant des taux sur le marché interbancaire (où les banques se prêtent entre elles à de courtes échéances).
Ensuite, la faiblesse de la gouvernance. Au cours des années 2000, Dexia s'est engagée "dans une stratégie de croissance externe très rapide et mal maîtrisée, avec des acquisitions coûteuses, parfois hasardeuses", relève Didier Migaud. Les signaux annonciateurs de la crise, en 2007, n'ont pas été pris en compte. Le groupe, au contraire, a accéléré sa stratégie de croissance en cherchant à tirer parti des difficultés de ses concurrents. Le conseil d'administration, qui comptait peu d'experts ou de professionnels aguerris aux questions bancaires, ne s'est pas opposé à une telle stratégie qui a perduré jusqu'au milieu de l'année 2008, c'est-à-dire bien trop longtemps compte tenu de la montée des risques et de la dégradation rapide du résultat du groupe".
Une supervision éclatée
Quant à la supervision, elle n'était pas efficace, car trop éclatée entre régulateurs belges et français. Enfin, la régulation imposée aux banques (la fameuse règle de Bâle) n'a pas plus été utile pour empêcher le désastre, puisqu'elle leur permettait de se financer grâce à des obligations publiques - à l'époque considérées comme sûres - sans aucune pondération du risque.
Le premier sauvetage passe par des garanties publiques et une augmentation de capital financée par la puissance publique belge et française, sans qu'aucun effort ne soit demandé aux actionnaires existants. Un "choix critiquable", a encore jugé Didier Migaud. Et pour cause : "Les participations publiques prises, soit 2,7 milliards d'euros pour les entités publiques françaises - État et Caisse des dépôts et consignations (...) -, ont rapidement perdu la totalité de leur valeur."
C'est alors que l'État se résout finalement à devenir actionnaire direct et à mettre son nez dans la gouvernance. Mais l'accalmie de 2009-2010 n'est que de courte durée. La crise des dettes souveraines vient prendre le relais de la crise de la liquidité bancaire pour donner le coup de grâce à Dexia, qui voit sa notation dégradée à cause de son exposition aux dettes publiques du sud de l'Europe.
Des risques pendant 40 ans
Morale de l'histoire, "faute de cadre européen permettant d'organiser la disparition de Dexia sans intervention financière des États et sans impact sur les finances publiques, le schéma retenu a fait porter l'essentiel des risques passés et la totalité des risques futurs sur les États français et belge", pendant 40 ans, prévient la Cour des comptes, au travers de son premier président.
D'autant que les prêts toxiques accordés aux collectivités locales, "dont l'encours représente encore 10,5 milliards d'euros", font peser "un risque important sur le bon déroulement de la phase de gestion extinctive à venir". Les impayés des collectivités sont en effet "à un niveau modeste, mais en forte croissance"...
D'où l'importance, pour l'avenir, de la construction de l'Union bancaire européenne avec un superviseur unique dépendant de la BCE et de la mise à contribution prévue des créanciers privés au moment d'un sauvetage ou d'une mise en faillite de banque.
Des responsables impunis
Qui est responsable de cette débâcle ? Personne n'a réellement voulu aller les chercher. Au point que "la plupart des anciens dirigeants bénéficient aujourd'hui d'avantages importants, en particulier de retraites chapeaux", dénonce Didier Migaud. Certes, le président du conseil d'administration et administrateur délégué de 1999 à 2006, Pierre Richard, ainsi qu'Axel Miller, ancien administrateur délégué, ont été écartés. Mais "aucune action de mise en cause ou de recherche de la responsabilité des anciens dirigeants n'avait eu lieu à l'initiative des nouveaux dirigeants, des actionnaires ou des États avant octobre 2011. Le groupe a invoqué un risque d'image pouvant porter atteinte au bon déroulement du redressement", continue le premier président de la Cour.
Ce n'est que sous la menace d'un recours judiciaire, dont la possibilité a été relevée par la Cour lors de la préparation de son rapport, qu'a finalement eu lieu en 2012 une "négociation d'une réduction transactionnelle de la retraite de M. Pierre Richard, qui est passée de 563 000 euros annuels à 300 000 euros, montant qui n'intègre pas sa retraite de la fonction publique". Une situation qui n'a visiblement pas choqué les nouveaux dirigeants : "Le conseil d'administration s'est satisfait de cette issue et a renoncé à exercer les voies de recours", souligne Didier Migaud.
Des retraites chapeaux confortables
D'ailleurs cinq autres dirigeants jouissent toujours de leur retraite chapeau, à en croire la Cour, qui souhaite exercer un recours en justice "susceptible de réduire substantiellement les pensions de l'ensemble des bénéficiaires". Une voie judiciaire qui s'éteindra dès l'année prochaine, si rien n'est fait...
Mais même si le recours devait avoir lieu, quatre anciens dirigeants remerciés jouiraient toujours de leurs indemnités de départ, négociées en plus des indemnités classiques de licenciement. Des sommes qui représentent, selon la Cour des comptes, entre 595 000 et 765 000 euros. Confortable, en particulier pour deux d'entre eux, qui ont bénéficié d'une réintégration immédiate dans la fonction publique, dans leurs corps d'origine.
Merci qui, Merci L'UMp.
Modifié en dernier par Bibpanda le 18 Juil 2013, 20:15, modifié 1 fois.
Big brother is watching you
-

Bibpanda - Rédacteur

- Messages: 51045
- Enregistré le: 24 Déc 2005, 19:11
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
sonny a écrit:richardB a écrit:lol on devrait tous donner 1euros ou 50 centimes avec l'impression du recu fiscale, l'UMP ne pourrait pas suivre mdr
Il y avait eu ça pour la mairie de Paris suite à la pelouse saccagée par la manif pour tous. La mairie de Paris avait reçu un max de chèque d'1 euro mais en avait encaissé aucun pour ne pas avoir à envoyer des reçus qui couteraient plus cher que ce qu'ils ont reçu.
Question bête mais question quand même. Ont-ils le droit de refuser un don ?
- John
- La nonne

- Messages: 6935
- Enregistré le: 15 Déc 2005, 00:54
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
Bibpanda, un petit resume d'un pave pareil sa serait sympa 
Modifié en dernier par EL MAGNIFICO le 18 Juil 2013, 19:19, modifié 1 fois.

R.I.P COLIN
La SPL c'est du LOURD@Beenie
-

EL MAGNIFICO - Rouquemoute Ultime

- Messages: 43211
- Enregistré le: 30 Juil 2003, 22:23
- Localisation: Dublin et Lille
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
EL MAGNIFICO, UMP = enculé
J'ai pas lu mais je pense qu'on peut le résumer ainsi
J'ai pas lu mais je pense qu'on peut le résumer ainsi
-Vainqueur Coupe Confédération 2009 / Coupe UEFA 2008, 2015 / CdF 2012 / L1 2014
-Finaliste Mondial 2010 / Euro 2008, 2016 / CdL 2010, 2011, 2015 / CdF 2009, 2013 / L2 2012 / TdC 2012
-Finaliste Mondial 2010 / Euro 2008, 2016 / CdL 2010, 2011, 2015 / CdF 2009, 2013 / L2 2012 / TdC 2012
-

sonny - Keep on Roolin' baby

- Messages: 70727
- Enregistré le: 19 Déc 2002, 20:50
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
Comme c'est une info sur l'époque où Carla était 1ère dame, je la poste ici : son site a couté aux français 410k€, pour un site en wordpress pas à jour, avec un skin lambda, et avec des failles de sécurité pire que celles d'OMLive. 
http://bluetouff.com/2013/07/21/carla-b ... tribuable/
Il ne faut pas voir là dedans une volonté de se faire du fric sur notre dos, mais juste l'absurdité du système administratif français : si on ne dépense pas le budget prévu, il sera moins élevé l'année suivante, donc on dépense sans réfléchir et sans compter.
http://bluetouff.com/2013/07/21/carla-b ... tribuable/
Il ne faut pas voir là dedans une volonté de se faire du fric sur notre dos, mais juste l'absurdité du système administratif français : si on ne dépense pas le budget prévu, il sera moins élevé l'année suivante, donc on dépense sans réfléchir et sans compter.
regarde la localisation
-

sillicate - Minet râle

- Messages: 29832
- Enregistré le: 07 Jan 2005, 16:54
- Localisation: pizzeria
Re: [Topic Politique UNIQUE] Mutations et Enjeux
Arroser ses amis quand on est au pouvoir ça fait parti du paysage politique français depuis longtemps 

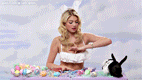
Si l'homme est l’œuvre de dieu, alors les religions sont celles du diable.
-

dlb1664 - Des seins animés addict

- Messages: 41571
- Enregistré le: 17 Juin 2005, 13:05
- Localisation: Jura Sick Park
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 48 invités

